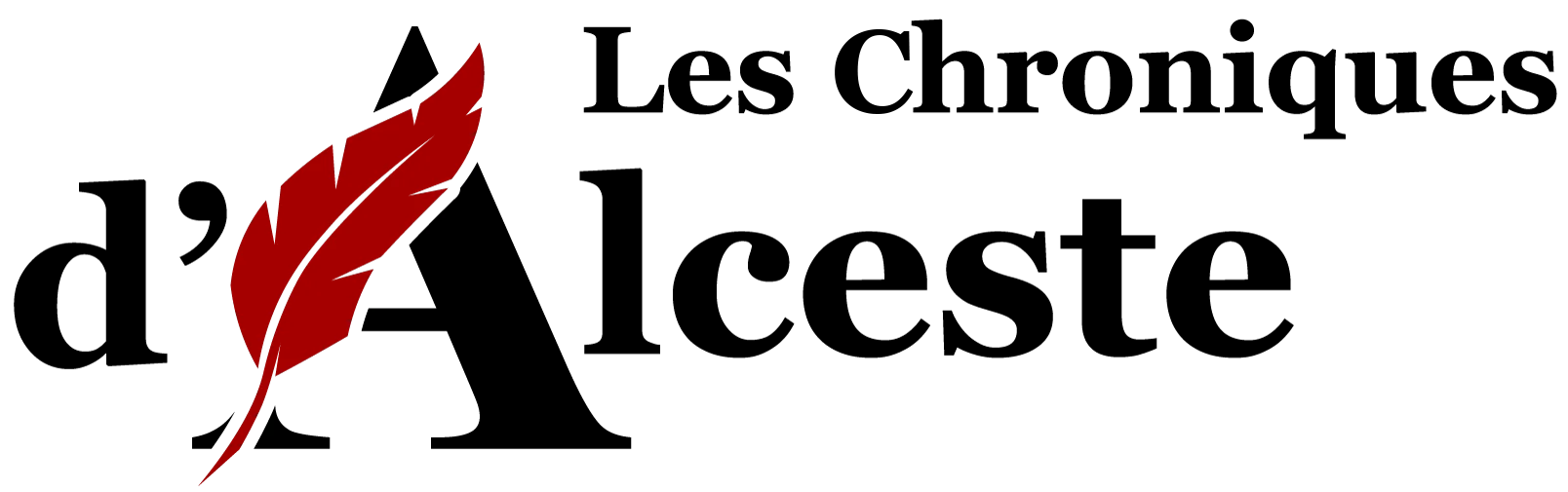Un mentaliste globe-trotter.
L’Effet Papillon est programmé aux 3S à 16h20.
David Season : Bonjour Taha Mansour, vous êtes mentaliste et serez à Avignon pour l’Effet Papillon, salué à la fois par le public et la critique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le mentalisme ?
Taha Mansour : Absolument ! Alors le mentalisme, ça va être un art du spectacle qui va mettre en scène des phénomènes impossibles reliés aux gens, à leur pensée, à leur choix. Là où par exemple un magicien, lui, va faire des phénomènes impossibles avec des choses tangibles comme des objets, des téléportations, des lévitations… le mentaliste, lui, va s’intéresser plus à mettre en scène des expériences impossibles avec des choses intangibles comme deviner les pensées, influencer les choix, créer des connexions entre des personnes, s’intéresser aux comportements des gens.
Avez-vous toujours voulu vous produire sur scène ?
Alors, oui mais pas sous ce format-là. Ma première forme artistique, à la base, c’était le chant. Je fais du chant depuis que j’ai six ans. J’étais dans un groupe, on a fait plusieurs concerts, j’ai fait plusieurs années de comédie musicale également. J’ai toujours eu un attrait pour l’art. Et quand j’étais au lycée, je me rappelle que je disais à mes professeurs que plus tard, quand je serai grand, je voudrais être chanteur et ingénieur.
On n’est pas très loin du compte aujourd’hui. Le mentalisme, moi je l’ai découvert quand j’étais au lycée et j’ai eu un déclic pour lui. Je ne savais pas à ce moment-là que je voulais devenir mentaliste, professionnellement je veux dire.
Et qu’est-ce qui vous a donné l’idée de créer ce spectacle, l’Effet Papillon ?
Le spectacle est parti de plusieurs envies de ma part.
Il a beaucoup évolué parce que ça fait sept ans maintenant que je le joue. Mais la toute première intention, c’était la découverte de ce phénomène-là, l’effet papillon, qui explique que les battements d’ailes d’un papillon au Brésil peuvent engendrer une tornade au Texas.
C’est la façon dont les petites choses dans le monde peuvent avoir généré un effet domino, un effet boule de neige, ce qui revient au même.
Et quand j’avais découvert ce phénomène-là en cours de physique, il y a une idée qui m’est venue dans la tête. Je me suis dit, et si nous, en tant qu’êtres humains, on était des papillons et que chacune de nos actions, la boisson qu’on prenait, un café, le fait de dire bonjour ou pas, la personne qu’on croisait dans la rue, en réalité, impactait fortement notre vie et créait un impact plus fort sur les autres autour de nous.
C’est une idée qui m’est restée et qui m’a poussée à écrire ce spectacle-là.
Il y avait aussi une autre envie sous-jacente. Il y a un manque d’émerveillement de la société. On tombe de plus en plus dans un fatalisme, dans une passivité absolue. Et pour moi, l’émerveillement, ce moment-là où je me laisse juste aller et je me dis : «je ne sais pas ce que je viens de voir mais c’est beau et j’adore ce moment-là, pour moi, c’est une émotion qui est très forte et qui est très positive pour la société. Donc c’était aussi l’envie derrière ce spectacle-là de retransmettre quelque chose qui dépasse le spectacle. C’est-à-dire que les gens repartent non pas juste avec des questionnements et des pensées sur le spectacle mais des interrogations sur leur vie et sur la société.
C’était ça mon objectif.
Vous avez fait Centrale, vous l’avez évoqué, vous avez décidé d’être ingénieur. Est-ce que cela vous aide dans la conception de vos spectacles ?
Oui, absolument.
Je réalise, en échangeant avec d’autres metteurs en scène et comédiens que je suis très ingénieur, même dans ma casquette artistique. Un ingénieur, c’est quelqu’un qui étudie des systèmes, utilise des outils pour tendre vers un objectif.
En fusionnant ça avec mon parcours théâtral, aujourd’hui mes mises en scène sont très ingénieur. Je me dis que chaque chose a son sens. J’essaie d’écrire des équations des personnages, les évolutions du rythme, je les considère comme des facteurs mathématiques, et ensuite je les fusionne pour créer quelque chose qui va être un peu cohérent.
Attention, ça ne veut pas dire que le public, lui, va voir quelque chose d’hyper direct, carré et mathématique. Au contraire, c’est plutôt un moyen pour moi de narrer l’histoire mais d’une manière stratégique.
Alors, justement, puisque ce n’est pas forcément carré pour l’auditoire, j’en témoigne, c’est qu’il y a beaucoup de poésie.
Vos spectacles comme l’Effet Papillon sont indéniablement emprunts de poésie. Quels sont les auteurs qui vous inspirent ? Avez-vous baigné dans la poésie depuis votre plus jeune âge ?
Je n’ai pas baigné dans la poésie, poésie mais c’est vrai qu’il y a plusieurs auteurs qui m’ont inspiré, pour différentes raisons.
Un qui m’inspire énormément, c’est Dan Brown, qui est, je pense, un de mes auteurs préférés, l’auteur du Da Vinci Code. Ce que j’adore dans ses livres et ce que j’essaie de remettre dans mes spectacles, c’est le fait que chaque chose a un sens. Chaque élément, chaque détail nous raconte quelque chose, et tout est relié, tout est interconnecté. Cette puissance-là dans l’écriture est très belle.
Dans le cinéma, moi, j’ai baigné beaucoup dans le cinéma, des réalisateurs comme Christopher Nolan m’ont beaucoup inspiré également.
Et James Thierrée, je pense que c’était là mon déclic pour faire du spectacle vivant, ma première vraie expérience théâtrale.
Avec les élèves de mon lycée, on avait fait une sortie scolaire. J’avais vu son spectacle, Le Tabac Rouge, qui parle du deuil ou de la mort d’un roi qui se fait hanter dans ses derniers moments par ses démons intérieurs et qui s’accroche au maximum à la vie. Mais il n’y a pas un mot qui est prononcé, en tout cas pas dans mon souvenir.Ce n’est que de la danse contemporaine, un décor gigantesque d’inspiration steampunk avec des miroirs, des danseurs qui grimpent, de la fumée, etc. Et pour la première fois, j’ai réalisé qu’on pouvait avoir de la poésie visuelle et qu’on n’était pas obligé de tout comprendre. Parfois, il y avait des choses qu’on pouvait comprendre sans pouvoir les expliquer.
Et cet élément-là, cette conception-là d’un objet ou un visuel qui suscite différentes réflexions, c’est quelque chose qui m’inspire beaucoup.
Et je fusionne un peu toutes ces différentes inspirations-là pour développer mon style qui, lui, aujourd’hui, est très minimaliste. Chaque objet est réfléchi pour raconter quelque chose.
Et sinon, mon objectif, c’est de mettre en scène les gens avant tout. Ce sont les gens qui montent sur scène qui sont mis en lumière. Il y a une musique qui est créée sur mesure pour pousser l’immersion, pour vraiment qu’on s’intéresse aux gens qui montent sur scène afin qu’ils ne soient pas juste des outils ou des objets à mon service.
Justement, parlons des spectateurs qui montent sur scène, qui sont mis à contribution. Vous les mettez en confiance. Avez-vous toujours eu le don de créer du lien de façon immédiate ?
Je suis ravi si j’arrive à les mettre rapidement en confiance, c’est un élément qui est très important pour moi.
Je pense que c’est quelque chose que j’ai construit. Je sais que j’ai toujours été très curieux des autres. Et je sais que ça a été une force.
Mais en plus, je pense sincèrement que ma posture est reliée à une de mes motivations qui m’a poussée à me lancer dans le spectacle, dans le mentalisme : c’était ma frustration concernant beaucoup de mentalistes que j’avais vus. La majorité des spectacles de magie ou de mentalisme que je voyais quand je m’étais lancé montrait un personnage arrogant qui se moque des personnes qui montent sur scène et qui met le public en opposition en mode « Vous voyez, moi je suis malin, j’ai fait un truc que vous ne savez pas. Bande de connards ! » Ça me frustrait énormément. Je me disais : on a le pouvoir dans nos mains avec la magie et le mentalisme d’émerveiller, de changer la vie de certaines personnes, littéralement, de donner de l’émerveillement à des gens peut-être qui dépriment, qui vont mal, etc. Et on l’utilise mal.
C’était hyper important de réfléchir à la façon dont j’accueille les gens, la façon dont je prends soin d’eux et la façon dont je les mets dans la lumière. Et comme ça a été beaucoup réfléchi, je pense que c’est ça qui transparaît. Mais ça n’a pas été un don, c’est vraiment une envie profonde et un vrai travail : à quel moment je les regarde, à quel moment ils montent sur scène, comment je les accueille, par quels mots, est-ce que je leur serre la main ou pas…
Vous êtes originaire de Brest. Quel est votre rapport à cette ville ?
Bonne question. J’ai eu un rapport très chaud, froid avec cette ville, toxique pour ainsi dire parce que j’ai grandi à Brest mais à différents moments de ma vie. Je suis né au Japon. Je suis resté trois ans là-bas.
On est arrivé à Brest quand j’avais quatre ans. De mes quatre ans à mes neuf ans, on était à Brest. Puis on est allé en Australie pendant quatre ans. On est resté en Arabie saoudite pendant un an et demi. On est revenu à Brest quand j’avais quatorze ans. Et j’ai quitté Brest après mes dix-huit, dix-neuf ans pour aller à Paris poursuivre mes études.
J’ai eu deux moments très forts de ma vie à Brest. C’est une ville qui est reliée à mon collège, ma jeunesse et également mon lycée prépa. Il y a des personnes, notamment mes professeurs, dont je suis très admiratif et avec lesquelles j’ai un fort lien.
Ma famille est toujours à Brest, donc j’ai toujours ce lien là-bas. Je pense que ça doit être relié au fait que j’ai beaucoup voyagé car je ne me sens pas lié à cette ville, tout comme je ne me sens lié à aucune ville en particulier. Je me sens citoyen du monde.
J’adore Paris, d’un point de vue culturel , c’est pour ça que j’y vis aujourd’hui. J’ai toujours eu la curiosité de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de voir les choses. Je voyage énormément.
Justement, est-ce qu’il y a un endroit du monde qui vous a particulièrement marqué ?
C’est une bonne question. Alors, récemment, un endroit que j’ai visité et dont je suis tombé amoureux, c’est le Portugal.
Je ne sais pas pourquoi, je suis allé m’isoler là-bas parce que j’étais en train d’écrire un livre qui devrait sortir début 2026. Je suis parti faire une semaine et demie de résidence d’écriture là-bas et je n’y étais jamais allé auparavant. Les Portugais m’ont paru très ouverts d’esprit, très curieux.
Ils sont tous au moins trilingues : ils parlent le portugais, le français, l’anglais, et d’autres langues aussi. Il y a une vraie ouverture culturelle. Plusieurs communautés coexistent : une communauté brésilienne, une communauté espagnole…
Ils sont tous dans une envie de découvrir les autres. Il y a un vrai sens de l’accueil, un vrai sens du travail, et j’apprécie même le paysage, la nourriture. Je sais que c’est un endroit où j’aimerais bien séjourner de nouveau.
Ma prochaine destination sera le Japon parce que je n’y suis pas retourné depuis qu’on est parti quand j’étais jeune, donc je n’ai aucun souvenir.
Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre ?
Peut-être mes aspirations et mes projections sur le spectacle vivant et le milieu artistique en général.
Je trouve qu’on est de plus en plus en train de se concentrer sur le futile. Et moi, ça m’exaspère.
Dans les créations, même aujourd’hui, on prend de moins en moins de risques, on ose de moins en moins affirmer fortement des idées et on explore moins des choses qui peuvent être très intéressantes.
Aujourd’hui, avec la baisse du budget de la culture, on voit les formes de divertissement qui sont mises à l’honneur : c’est le burlesque, le boulevard, la comédie absurde, que j’adore, mais ça ne rend pas compte de la diversité de la culture.
Les films primés sont presque exclusivement des films engagés sur des thématiques actuelles, qui ne font que dénoncer, et on n’a plus rien, je trouve, qui émerveille ou qui stimule, qui donne une vision positive de l’avenir. Et je trouve ça assez triste.
Pour moi, l’état d’esprit, l’état de la société est aussi relié à un imaginaire collectif. Pour donner un exemple, l’année dernière, les seuls en scène nommés aux Molières traitaient tous, ou presque tous, du viol. C’est bien de dénoncer un fait de société. Pour autant, est-ce que l’art n’a pas aussi pour vocation justement de créer un espoir, de projeter les gens dans un futur meilleur et justement les re-stimuler ? C’est ce que j’essaie de faire dans mes spectacles.
Il est essentiel de redonner du c’est possible et de faire grandir cette petite étincelle de magie que je trouve qu’on perd énormément aujourd’hui dans notre société, dans l’art, dans la recherche, dans l’innovation… Et si on arrive à se reprojeter, à redonner de l’espoir, je pense que ça fera un bien fou à tout le monde.
https://chroniquesdalceste.fr/leffet-papillon-de-taha-mansour/